(cliquez sur la photo. vous pouvez mettre le son)
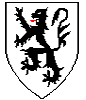 Accueil
Accueil
Le Hameau de Flaujac : Le Fort et Le
Barri
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Flaujac en 2005 n'est plus vraiment un village de paysans, même s'il en reste quelques uns. C'est un coquet village, niché au bas du flanc d'une petite colline dominant un vallon verdoyant face à la vierge de Vermus, et dont la pente douce se meurt au contact des peupliers qui bordent la Boralde de Flaujac.
Les maisons, pour la plupart, ont été rénovées ces vingt dernières années dans le style le plus pur.
Ayant perdu sa vocation paysanne, Flaujac regarde son Histoire. Il se remémore. "En 1443, ses habitants demandèrent à Antoine de Catelnau, seigneur de Calmont-dOlt, l'autorisation de construire une enceinte fortifiée à l'intérieur de laquelle ils auraient un refuge en cas de danger. L'acte de concession fut rédigé dans le château de Saint Côme, le 20 mars 1442".
Depuis lors, le village est divisé en deux parties : Le Fort et le Barri.
Le Barri forme la partie ouest du village, Le Fort la partie est. Le Barri constitue un serpentin de maisons autour d'une rue unique. La plupart des maisons ont retrouvé, avec le ravalement, leur gaillardise d'antan. La rue, côté Ouest, aboutit à une petite place sur laquelle trône une croix (à ne pas escalader comme nous le faisions petits) et qui donne accès à droite à l'Église, à gauche à l'École. (A droite, l'Église, à Gauche l'École, ne voyez là aucune arrière pensée politique !!).
Cependant les temps changent : l'Église n'a plus de Curé (Le dernier en date fut l'abbé Albert Ginisty, qui assumait également la charge de professeur de mathématique au collège, curé prétendu sévère par ses paroissiens, qu'il n'hésitait pas à mettre au piquet s'ils arrivaient en retard à la messe, et l'École a cessé depuis longtemps de recevoir des élèves. La dernière maîtresse en place, Madame Marcillac, a dû certainement partir avec la clef !. Un particulier a racheté les murs pour y faire une demeure privée. Le presbytère s'est refait une beauté pour héberger des locataires. Seule l'Église, sur le fronton de laquelle est écrit : "Ici est la maison de Dieu et la porte du ciel", reste fermée la plupart de l'année; tant pis pour les prétendants au ciel, qui veulent en franchir le seuil. Ils attendront. Je suppose que Dieu est parti avant la fermeture !
Le village aurait-il perdu son âme? Sans doute un peu, mais ne soyons pas pessimiste et ringard. En effet, en rempart de cet abandon, se sont constituées deux blocs solides : le Foyer Rural, qui a longtemps galéré entre l'école et le presbytère avant de trouver son siège définitif au presbytère, et l'Association pour la Sauvegarde du Fort de Flaujac.
Le cimetière, dans la première moitié du siècle dernier, jouxtait l'église. Les enfants de l'école voisinaient avec les morts, apparemment en bonne entente. Il s'est déplacé ensuite vers l'ouest, presque le far ouest (si on pense aux difficultés de déplacement des personnes âgées), à l'extérieur du village. Les corps ont été déterrés, pour tout ou partie, les restes oubliés dans ce déménagement précipité, faisant la joie du jeu aux osselets durant les récréations des écoliers. Çà a été sans doute pour lui l'occasion de revêtir des habits neufs. Le marbre y a fait son apparition et les tombes rivalisent de luxe. La conscience des vivants ou plutôt des survivants trouve-t-elle ainsi un peu plus de paix ou les morts, parfois pauvres de leur vivant, se réjouissent-ils de ces marques de confort ??? Au centre du cimetière se dresse une belle croix, encadrée de 4 cyprès. C'est au pied de cette croix que les familles, entourées des villageois, viennent dire un dernier et pieux adieu à celui ou celle des leurs qu'ils viennent d'inhumer. C'est l'occasion pour tout le village de se retrouver, de se compter, de serrer leurs rangs, de se raconter, bref de pérenniser leur cohésion communautaire; c'est le pacte des vivants autour du mort, si j'ose dire. Il se trame en échangeant quelques mots, des mots qui prennent toute leur densité symbolique de côtoyer ainsi la mort.
Mais revenons au Barri. Le rempart du Fort, construit au XVème siècle, une trentaine de maisons vinrent s'y adosser de l'intérieur. Pour la plupart, les habitants qui y firent leur demeure, conservaient une maison dans ce qui devenait le Barri. Le mouvement actuel se fait à l'opposé: plusieurs propriétaires du Fort ont vendu leur maison après s'être installés dans une maison neuve à l'extérieur. Quant aux nouveaux propriétaires, la plupart non originaires de la région mais amoureux des "vieilles pierres", ils n'ont de cesse de rénover, embellir, retrouver le style historique de leur rêve résidentiel.
Je suis étonné qu'à l'heure actuelle, aucune de ces grandes maisons du Barri, la plupart sous occupées, n'aient pas ouvert leurs portes à des chambres d'hôtes, Flaujac étant tout près de grands pôles touristiques, tels que la vallée du Lot, le plateau de l'Aubrac, Laguiole et autres... dans ce grand parc touristique que devient l'hexagone français au sein de l'Europe.
Un petit mot sur l'église de Flaujac : je cède la parole à l'abbé Ginisty, dernier curé du village.
" Une visite attentive à l'église éveille la curiosité. C'est un bâtiment modeste, qu'on ne rattachera pas aux grands types d'architecture mais qui, avec sa base romane, ses trois nefs, ses vieilles pierres sculptées, ses boiseries, témoigne d'un passé religieux..."
Les Flaujacois restent très attachés à leur Église. Tous les jours que Dieu fait , ses cloches résonnent sur les toits du village. Elle ouvre encore ses portes pour les grandes occasions : Noël, Pâques, La Toussaint, les mariages, les décès; Elle se remplit alors comme les dimanches d'autrefois.
L'intérieur est gracieusement et soigneusement entretenu par les âmes charitables. Les personnages de la crèche, grâce à un jeune homme artiste, flaujacois par ses parents, ont retrouvé leur fraîcheur authentique. C'est une très belle crèche devant laquelle ont rêvé des générations d'enfants et leurs parents avec eux. Au tout devant se tenait un ange qui remerciait en opinant de la tête chaque fois qu'un sou tombait dans son escarcelle. Le plaisir était tel que la quête des sous auprès des parents était sans limite , cependant que le tronc de l'Église, près du bénitier, faisait grise mine. Tous les Noëls, chaque personnage retrouvait exactement sa place, mais l'émerveillement des enfants était chaque fois nouveau.
Le temps passe, les jours se succèdent, amenant chacun son lot de joies et de peines, mais aucun d'eux ne revient, ni ne se ressemble vraiment. Ce qu'il en reste c'est des souvenirs. Les choses du passé, même relookées, ont englouti en elles-mêmes les émotions qu'elles ont suscitées en nous. Il nous en reste parfois la nostalgie, nostalgie qui nous tient, nous retient telle une illusion qui n'en finit pas de s'éloigner de nous.
Le prêtre grimpait l'escalier en colimaçon pour atteindre la chaire. Il refermait le portillon derrière lui. Pour ce qu'il avait à dire à ses paroissiens, il avait besoin d'une certaine intimité protégée. C'est alors que de son perchoir, d'où il dominait toutes ses ouailles, il commençait son sermon. Les femmes et les enfants , ramassés sur le devant de l'Église, se montraient attentifs; Les hommes, concentrés à l'arrière fond de l'Église, tout près de la porte de sortie, étaient souvent plus dissipés. Sans doute, du haut de sa chaire, le curé parcourrait-il d'un regard compatissant ses paroissiens, dont il connaissait la grandeur et la misère.
Il y avait quelques places, réservées tacitement aux grandes familles C'était les premiers rangs pour les hommes comme pour les femmes. Leurs membres paraissaient plus grands et plus beaux que tous les autres. Il chantaient avec assurance. En tombant dans l'escarcelle des enfants de choeur ou des marguillières, leur aumône ne tintait pas et à la sortie de la messe, ils avaient pour chacun, un mot gentil mais quelque peu condescendant. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, même s'il arrive qu'ils se côtoient dans les cuisines
La cuisine humaine est complexe. Les us et coutumes, comme les mauvaises herbes, ont des racines tenaces, infiltrées dans la profondeur du sol . La révolution française a laissées intactes certaines habitudes héritées de l'ancien régime.
Les uns et les autres étaient sans doute de bons paroissiens, même s'ils n'étaient pas tous de bons croyants. mais les traditions se foutent pas mal des croyances. Les croyances sont multiples et parfois éphémères, les traditions perdurent à travers leurs couches sédimentaires successives, comme autant de dépôts fossilisés d'expériences passées.
Les vieux murs de l'Église auraient besoin d'un ravalement : les vieux crépis se détachent, laissant l'eau s'infiltrer entre les joints fragiles des vieilles pierres. Cela est significatif de l'esprit des temps modernes : priorité est donnée aux demeures individuelles. De nos jours, chaque maison individuelle ou presque , a fait peau neuve. La maison collective, sur le fronton de laquelle est écrit : "Ici est la maison de Dieu ", est abandonnée à l'usure du temps. Devant la poussée de l'individualisme, la chose publique (Res publica) a bien du mal à résister.
(Suite en construction)
Suite : Flaujac vous ouvre les portes du passé, où résonnent encore les clameurs de l'Histoire !

je reprends la plume avec le désir de poursuivre cette construction que j'ai laissée en jachère il y a quelques années déjà. L'inspiration est-elle au rendez vous ? L'écriture me le dira bientôt, du moins je l'espère. Il faut pour cela se détendre, s'oublier et laisser aller.
Avec ce peu de recul que j'en ai, je dirai qu'au fond les vieilles pierres du Fort, tout autant que celles du Barri traversent mieux le temps que les êtres humains qui en ont fait leur abri. Il est vrai qu'elles nous préexistaient. Aussi nous prenons soin d'elles. Nous les habitons autant qu'elles nous habitent dans nos rêves, nos projets et nos réalisations. Elles nous offrent leur résistance et leur force, nous leur offrons tout l'art de notre sagesse et de notre goût pour la beauté. Ainsi elles conservent les traces de nos émotions et plus généralement de notre passé. Nous allons même jusqu'à leur prêter un avenir dont nous espérons qu'il traversera les siècles à travers les générations successives de nos progénitures.
Mon projet actuel est de situer ce hameau de Flaujac dans son contexte historique et géographique élargi au Rouergue et au-delà à la France.
Savez- vous par exemple que Flaujac était une commune jusqu'à sa fusion avec Espalion en 1858 ?
Savez-vous que Le Rouergue (Roergue en occitan) est une ancienne province du sud de la France correspondant approximativement à l'actuel département de l'Aveyron crée au moment de la Révolution ?. Après avoir fait partie du comté de Toulouse, il fut rattaché à la Guyene avant d'en être détaché lors de la formation de la province de Haute Guyene en 1779.
Savez- vous que le roman (langue dérivée du latin) était la langue écrite du territoire gallo-romain, Que la partie Nord de ce qui deviendra la France parlait la langue d'Oil et la partie Sud la langue d'Oc. A noter que Oil aussi bien que Oc signifiaient "oui". Ainsi dans le Ro-ergue, on parlait la langue d'oc qui elle-même se déclinait en patois régionaux, parfois différents d'une localité à l'autre. Ce n'est que vers le XVII siècle que le françois, devenu le français commença à se généraliser sur tout le territoire de France. Cependant l'Église et les clercs, durant tout le Moyen-Age produisaient leurs écrits en latin.
Le Rouergue comprenait notamment le comté de Rodez, ainsi que Millau et Villefranche-de-Rouergue
Le Rouergue (avec l'Agenais, le Quercy et le Périgord) a été rattaché à la généralité de Guyene dès 1579, dont le siège initialement à Bordeaux avait été transféré à Montauban.
Réuni au Quercy en 1779, il forma la province de Haute-Guyene où fut établie une assemblée provinciale composée de cinquante-deux membres : évêques de Rodez (président), de Cahors, de Vabres et de Montauban, 6 membres du clergé, 16 gentilshommes, 13 députés des villes, 13 députés des campagnes. Il y avait, en outre, deux procureurs généraux syndics et un secrétaire archiviste. On se souvient encore dans le Rouergue de ses efforts et des règlements qu'elle fit pour améliorer l'agriculture et l'industrie, ainsi qu'un grand travail de cadastrage.
À la Révolution, la province fut transformée en département, à l'exception du canton de St-Antonin-Noble-Val qui fut détaché lors de la création du département de Tarn-et-Garonne en 1808.
Essayons de remonter encore plus loin dans l'Histoire, pour y apprendre notamment qu'après avoir été celtique, la Gaule fut romaine, qu'elle n'épousa le christianisme (catholicisme) que tardivement tout en continuant à honorer une divinité celte (Ruth). Le Rouergue, auquel nous nous intéressons avant tout se confondra plus tard, au moment de la révolution, avec le tout nouveau département de l'Aveyron.
Avant la conquête romaine, le Rouergue était habité par les Rutènes, Ruteni, peuple celte d'Europe centrale arrivé vers le IVi ème siècle avant J-C. Peuple puissant, les Rutènes avaient trois cités principales : Albi , première ville créée par les Rutènes où se concentrèrent les pouvoirs, puis Segodunum, en langue celtique "montagne à seigle" (Rodez) ; Condatemagus, ville du confluent (au quartier d'Embarri, près de Millau), et Carentomagus, ville des parents ( Caranton). Sur tous ces points on a découvert des ossements, des monnaies, des médailles, des poteries et d'autres objets d'art et d'industrie qui semblent confirmer la position de ces trois cités gauloises.
Voisins et alliés des Arvernes, les Rutènes les suivirent dans leurs expéditions au-delà des Alpes et combattirent dans leurs rangs pour l'indépendance nationale. Bituitos, chef des Arvernes, comptait dans son armée vingt-deux mille archers Rutènes, lorsque, joint aux Allobroges, il marcha contre le consul Quintus Fabius Maximus et lui livra bataille au confluent du Rhône et de l'Isère, en l'an 121 avant l'ère chrétienne. On sait que l'armée confédérée fut vaincue et qu'une partie du pays des Rutènes se trouva comprise, sous le nom de Rutènes provinciaux, dans la Provincia romana, qui s'étendit jusqu'au Tarn.
On appela Rutènes indépendants ceux qui habitaient sur la rive gauche du Tarn ; mais ces derniers ne tardèrent pas à subir le sort de leurs frères. Ayant pris part à l'héroïque révolte de Vercingétorix contre César, ils furent vaincus et soumis. Dès lors, comme le reste de la Gaule, tout le pays des Rutènes rentra sous la domination romaine. Dans la division des Gaules par Auguste, il fut compris dans l'Aquitaine. Rome y établit des colonies, y bâtit des temples, des cirques, des aqueducs ; des voies publiques sillonnèrent le pays dans tous les sens. Au Ve siècle, on y parlait la langue latine.
Ce fut, dit-on, St Martial qui, le premier, vint prêcher l'Évangile aux Rutènes, en l'an 250. Au IVe siècle, les chrétiens étaient déjà nombreux dans le Rouergue. Cependant, au Ve siècle, Ruth, la divinité celtique, y était encore adorée. St Amans entreprit de convertir ce peuple. « Un jour que celui-ci sacrifiait à Ruth, dit un historien, Amans apparut et il lui reprocha son impiété et ses excès ; mais, voyant qu'au lieu de se rendre aux efforts de son zèle il entrait en fureur contre lui, il invoqua le Seigneur, et tout à coup d'épaisses nuées s'amoncellent, le tonnerre gronde, éclate, et l'odieux simulacre tombe en pièces. » À cette vue, les Rutènes se jettent aux pieds du saint et demandent le baptême. Cependant, en rendant aux Gaulois leurs droits politiques, l'empereur Honorius leur avait imposé des contributions exorbitantes. Amans racheta les Rutènes de ce tribut. Cette sollicitude acheva de lui gagner les cœurs.
Après avoir fait partie de la province romaine , le Rouergue fut incorporé à la couronne de France. La capitale de la province ne fut transférée à Rodez, plus centrale, qu'à la Révolution.
Les comtes de Rodez jouissaient des droits régaliens, avec pouvoir de faire battre monnaie, de lever l'impôt, de créer des sergents, etc. À leur avènement au comté, ils étaient couronnés par l'évêque de Rodez, assisté du dom d'Aubrac. Outre les quatre châtellenies, qu'ils regardaient comme les clefs de la province, ils possédaient dans le Rouergue près de vingt-quatre châteaux et un grand nombre de fiefs et douze baronnies (dont Calmont -d'Olt).
Le Comté de Rodez ne passa aux Armagnac et ne fut définitivement rattaché à la couronne que sous Henri IV en 1607. Il retrouva enfin une relative tranquillité après les turbulences, de la guerre de cent ans et des guerres de religion qui l'ont suivie, génératrices de peurs, de maladies telles que les épidémies de peste et de pauvreté du peuple.
La Guerre de cent ans
C'est une belle et tragique histoire qui voit l'arrivée des anglais au pouvoir de la France soumise aux rivalités et guerres notamment entre les Bourguignons et les Armagnac sous le règne de Henri VI dit le roi fou. Pour le peuple, y compris celui de Guyenne, dont le Rouergue, soutenu par la couronne déchue, c'est une horreur permanente entre les impôts réclamés par les les anglais, celui réclamé par les comtés locaux et du clergé, les razzias des soldats des deux camps, les routiers, les épidémies de peste, ....etc...
Bref ce n'était pas la joie pour tout le monde. C'est dans ces conditions que les Flaujacois ont demandé la permission à leur seigneur le droit de se protéger à l'intérieur d'un Fort. (Voir plus loin les conditions de cette réalisation à partir des écrits de l'historien Espalionnais Henri Affre). Mais les malheurs de cette région n'allaient pas s'arrêter avec la guerre de cent ans. Ils se poursuivirent par la suite avec les guerres de religions entre catholiques et protestants. Puis vint le soulèvement des peuples contre l'ancien régime féodal moyenâgeux à travers la révolution française qui finalement finit par instituer la République ( Liberté, égalité, fraternité) mais aussi à mettre au pouvoir la classe des bourgeois génératrice du capitalisme qui, poussé à son extrême, deviendra le libéralisme économique générateur de crises financières que nos pays démocratiques connaissent aujourd'hui, tandis que d'autres, tels les pays sous domination religieuse musulmane entament à peine leur propre révolution populaire.
Déjà dans la croisade contre les Albigeois (Les Cathares), le Rouergue avait vu la plupart de ses villes, entre autres Millau, St-Antonin, Mur-de-Barrez, Laguiole, et Séverac, ravagées par Simon IV de Montfort (1208-1214). Ces mêmes villes furent les premières à se déclarer pour la Réforme dans le Rouergue. Bientôt il y eut des églises réformées à Espalion, à Villefranche, à Saint-Afrique, etc. Puis, la persécution s'en mêlant, les protestants prirent les armes. De là une longue et sanglante guerre que les fureurs de la Ligue menaçaient de perpétuer dans ce pays, et dans laquelle périrent plus de dix-huit mille protestants ou catholiques, sans compter les églises qui furent pillées et dévastées, les villes et les villages saccagés ou détruits.
N.B. Au fait savez-vous que ......
Nous avons la chance d'avoir dans nos compatriotes proches un historien du Rouergue et de l'Aveyron, Henri AFFRE. Celui-ci est né à Espalion en 1816 , a fait ses études au collège d'Espalion. Pour vous mettre en appétit, je vais commencer par citer quelques passages sur Flaujac, extraites de son livre "Lettres à mes neveux sur l'histoire de l'arrondissement d'Espalion" imprimé en 1858 à Villefranche, imprimerie de veuve Cestan née Moins.
"Gagnez, mes chers neveux, l'une des hauteurs ombragées qui font face à ce charmant village; plongez vos regards sur ses blanches maisons rangées avec coquetterie entre l'église et le fort; promenez-les ensuite sur le rivage qui les entoure, et vous direz avec moi, je n'en doute pas, qu'il est en vérité la perle de notre délicieux vallon; et que là sûrement, humble pasteur d'un troupeau d'élite, j'aurais été cent fois plus heureux que l'évêque le plus mitré, que l'empereur le plus opulent. Un riant coteau couvert de vignes à l'aspect vivifiant du midi l'abrite contre les rigueurs de l'hiver; des prairies, qui conservent long temps leur verdure et leurs fleurs, le séparent, mais sans s'en éloigner, de Boraldes à l'onde murmurante; à peu de distance se trouvent de frais ombrages; des solitudes en miniature pour le recueillement et le travail; un peu plus loin de deux villes, Espalion et St-Côme, pour briser au besoin la monotonie de la vie campagnarde,..."
Comment mieux dire, un siècle et demi plus tard !. Certes "le coteau riant" n'est plus couvert de vignes. Ses flancs en espaliers sont devenues des pâturages pour les brebis et maintenant pour les vaches et sont parfois sillonnés par des tracteurs colorés et bruyants. Le charme envoûtant n'en est pas moins présent, notamment pour les randonneurs de plus en plus nombreux, venus parfois d'horizons lointains. Les chemins de terre autrefois lissés par les charrettes tractées par les bêtes de somme, sont de plus en plus fréquemment parcourus par des deux roues tout terrain pour la plus grande jouissance de jeunes en quête d'adrénaline. La nature est la même, cette mère généreuse qui s'adapte à tous les temps pour apporter, sinon les nourritures terrestres, la paix et la détente. comme disait Lamartine: "Quand tout change pour toi la nature est la même et le même soleil se lève sur tes jours,...."
Mais poursuivons le propos de Henri Affre: " L'histoire de Flaujac, moins riche que son paysage, ne nécessitera pas de longs développements.... Cette paroisse était un simple prieuré en 1283. La curée fut établie ultérieurement. Bonneval en faisait partie; et par suite de cette dépendance, il intervint plusieurs transactions, la dernière en 1648, qui réglèrent la quotité de ces redevances auxquelles cette célèbre abbaye était tenue envers le curé de Flaujac et ce,..., pour l'administration des sacrements aux gens des métairies de Pussac et de Masse. Bonneval qui nageait dans l'abondance, ne lésinait jamais dans ses marchés; aussi le curé percevait-il pour raison de l'administration susdite cinq barriques de bon vin, net et marchant, une charretée de froment et douze cannes de bois de chauffage. Il lui était permis en outre de récolter dans la forêt de l'abbaye assez de glands pour les cochons; de prendre les secondes herbes d'un pré du couvent pour son cheval; enfin il avait son couvert mis à Bonneval et aux métairies déjà nommées toutes les fois qu'il lui convenait de s'y rendre...."

L'histoire ne dit pas si le curé de Flaujac avait, par la même occasion, droit de cuissage sur les Ames du couvent. Mais j'en doute fort, d'autant qu'à cette époque ses occupants étaient des Bernardins !!! (IoI).
Trêve de plaisanterie, continuons le récit de notre historien: " Cette localité (Flaujac) a fait partie de la baronnie de Calmont-d'Olt juqu'à une époque assez rapprochée de la révolution. M. de Curières, marquis de St-Côme, en était le seigneur haut justicier en 1772. Les religieux de Bonneval avaient à cette même époque la moyenne et la basse justice dans les trois quarts de la paroisse. Fatigués des trop grandes visites des compagnies anglaises qui les ruinaient et les excédaient de toute manière, les habitants de Flaujac, auxquels se réunirent ceux de Saulieux et de Tramon, demandèrent au seigneur l'autorisation de se construire un fort qui deviendrait leur asile au moment du danger. Antoine de Castelnau, seigneur pour lors de Calmont-d'Olt, fit droit à leur demande, et l'acte de concession fut rédigé à St-Côme, le 20 mars 1442, en présence de Jean, évèque de Cahors, de noble Jean de Salgues et de plusieurs autres personnes de distinction. En voici les dispositions principales : Le Fort sera construit au quartier dit del terral; les murailles auront une hauteur de de quinze cannes, cinq pieds d'épaisseur dans le bas et quatre au sommet. L'intérieur pourra, postérieurement, être divisé de telle sorte que chaque famille des localités susdites y ait son petit logement particulier. Le seigneur fixe à deux ans la durée de cette construction, se réservant la faculté d'accorder ou de refuser la prorogation d'une troisième année. Par ce même acte, les pétitionnaires sont dispensés pendant ces deux ans et au profit du fort en question, des deux manoeuvres dont ils sont redevables envers le seigneur, et à perpétuité de l'obligation de guet et de garde nocturne et diurne au château de Calmont, à la condition de remplir ce devoir en temps de guerre. Ils obtinrent enfin que l'un des habitants, au choix du seigneur, serait dépositaire de la clef du fort."
"La forme générale du fort est celle d'un quadrilatère irrégulier. Deux de ses façades cependant présentent les mêmes développements; ce sont celles du levant et du couchant qui mesurent chacune soixante-onze mètres. La façade septentrionale en mesure soixante, et la quatrième quarante-un. Le fort est entouré d'un machicoulis, et ses deux portes, derrières lesquelles jouaient deux herses énormes, étaient en outre, protégées à droite et à gauche par deux pièces d'artillerie faisant feu sur ceux qui menaçaient de les forcer.
Mais tout cela ne suffit pas à protéger complètement les habitants de Flaujac. Les guerres de religion éclatèrent... Les bandes catholiques ou calvinistes un peu nombreuses qui se présentèrent résolument devant la place réussirent toujours à s'en emparer, et y commirent, selon l'expression de leurs victimes, de très grands ravages. Une seconde requête fut adressée aux gens du seigneur à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter aux moyens de défense. Cette demande était trop légitime et conforme aux intérêts du baron pour éprouver un refus. Le juge et les autres officiers de la baronnie y firent droit le 9 décembre 1595, peu après une double invasion suivie des plus abominables excès. On construisit en conséquence sur le portail du mur d'enceinte qui trotégeait le village et qui arrivait jusqu'à l'église une guérite désignée dans le titre par le nom de Sostboquet, et une barbacane au-devant du même portail; on creusa de plus autour du fort et du mur dont je viens de parler un fossé bordé à l'extérieur de petites murailles, à l'instar de ce qui existait déjà autour d'Espalion et de Saint-Côme. Ce surcroît de précautions garantit-il Flaujac de toute invasion nouvelle ? Je l'ignore; mais il est certain qu'il ne put rien contre la peste, qui prit possession le 12 mai 1654."
Que penser de tout çà ?
Que notre hameau de Flaujac, situé en gaule celtique dans le Rouergue a connu une certaine prospérité et stabilité sous l'empire gallo-romain qui lui a apporté aussi le christianisme catholique; qu'après l'effondrement de l'empire, Clovis, originaire du peuple franc envahisseur venu des territoires germains et de religion arianiste (religion chrétienne , celle de Arius, non reconnue par les premiers conciles de Rome mais dominante en Europe de L'époque), sut se faire adopter par la Gaule en gagnant la guerre de Tolbiac contre les Alamans et en se faisant baptiser catholique comme il l'avait juré à son épouse qui était une fervente catholique,. Le royaume de France naissait en quelque sorte au Vème siècle de notre ère. A la mort de Clovis ses fils se partageaient le Royaume. Finie l'épopée romaine, finie la pax romana. La France allait être le théâtre de disputes d'influence et de territoires.... En 1420, elle passait sous la domination des anglais dans une France divisée en provinces concurrentes et sur lesquelles le roi n'avait que peu d'influence. Ainsi le règne de Charles VI (Le Roi fou) de 1380 à 1422, fut une calamité. Sa femme, la reine Isabeau de Bavière, organise un conseil de régence mais les grands se déchirent. Deux clans ennemis au XVème siècle se battent: les Bourguignons et les Armagnacs. C'est l'horrible guerre des Armagnacs et des Bourguignons. Au beau milieu du drame apparaît Henri V,roi d'Angleterre. C'est à lui que doit revenir le trône de France. Il remporte toutes les victoires dont celle d'Azincourt. Il finit par s'installer à Rouen. Le chef des Armagnacs est assassiné sous les yeux du dauphin Charles, fils de Charles VI. La haine des deux camps, Bourguignons et Armagnacs, est à son apogée. La reine Isabeau, hier du côté des Armagnacs, penche du côté des Bourguignons et se résout avec eux à passer une alliance avec les anglais (Traité de Troyes en 1420 qui prévoie qu'Henri V épouse Catherine de Valois, fille de Charles VI (le roi fou) et d'Isabeau sa femme)... Ainsi, Henri V, roi d'Angleterre, devient l'héritier en titre du trône de France: c'est la double monarchie. Le seul fils de Charles VI et d'Isabeau est destitué. Aux mains du clan des Armagnac, il va vivre réfugié à Bourges. Ironie de l'histoire en 1422, Henri V meurt suivi de près par Charles VI (son beau-père). La succession au trône de France s'annonce rude. C'est là qu'une petite provinciale, petite bergère de 16 ans de famille riche, Jeanne d'Arc, inspirée et mystique, vient s'adresser au "petit roi de Bourges " pour l'inciter à reprendre le trône de France". Elle le pousse, lui et ses troupes à Reims pour y être oint du sacre royal qui lui redonnera sa légitimité. C'est le début de la guerre dite de cent ans qui atteindra son but en 1429. Cependant il n'y a pas grand monde pour soutenir Jeanne blessée devant Paris, faite prisonnière devant Compiègne par les Bourguignons, et bientôt brûlée à Rouen sous domination anglaise.
Jeanne la pucelle est morte, son mythe peut naître !!!!.
Charles VII fait la paix avec les Bourguignons. C'est le traité d'Arras en 1435. Il lui ouvre les portes de Paris. Après la conquête de la Normandie (1450) puis de la Guyenne (dont le Rouergue), le Royaume de France est à lui. Il ne reste aux anglais que Calais.
...suite dans... années (aléatoire !) ..... venez y voir de temps en temps. Envoyez-moi vos remarques et vos corrections. Merci
Mes sources: - Henri Affre:Simples Recits Historiques Sur Espalion
- Albert Ginisty: Flaujac (Subervie, Rodez)
- Henri Affre: Lettres A Mes Neveux sur l' Histoire de l' Arrondissement d' Espalion.
- François Reynaert: Nos ancêtres les gaulois.
- Divers: encyclopédies, articles,...
Sites voisins: - Le village fortifié de Flaujac.Aurelle-Verlac